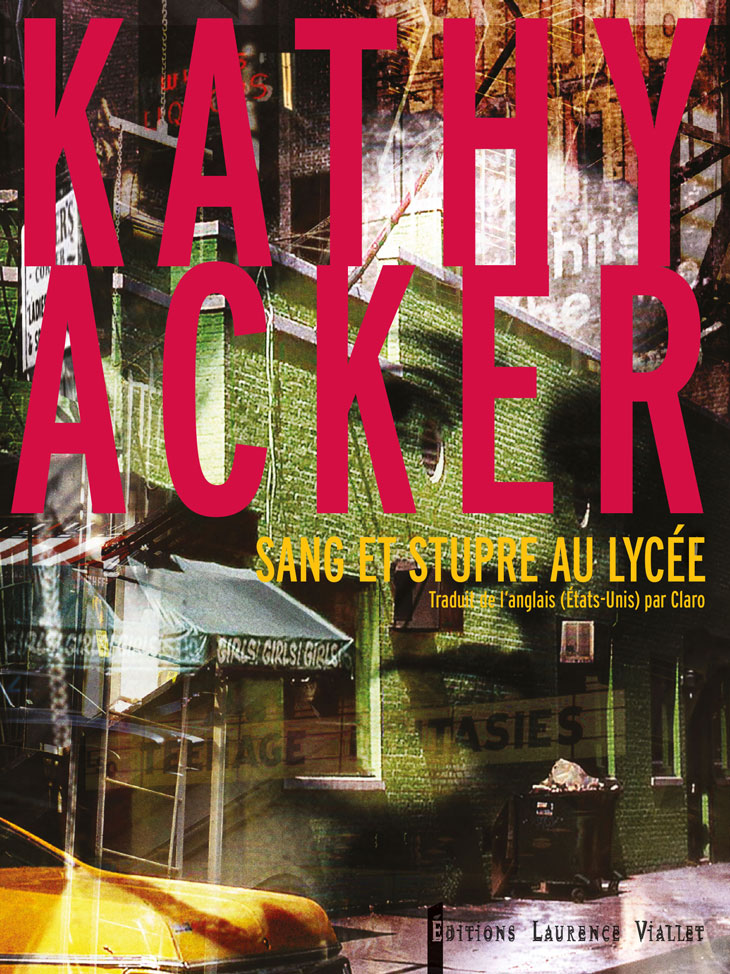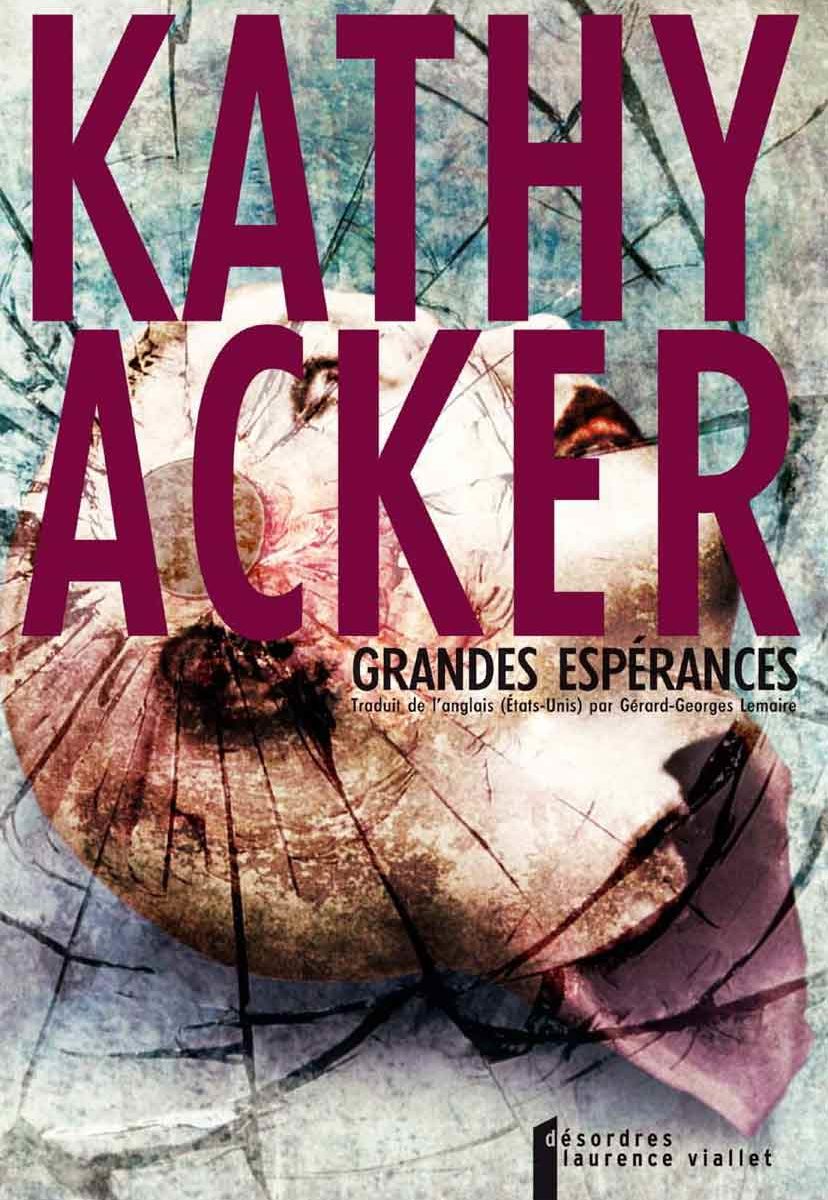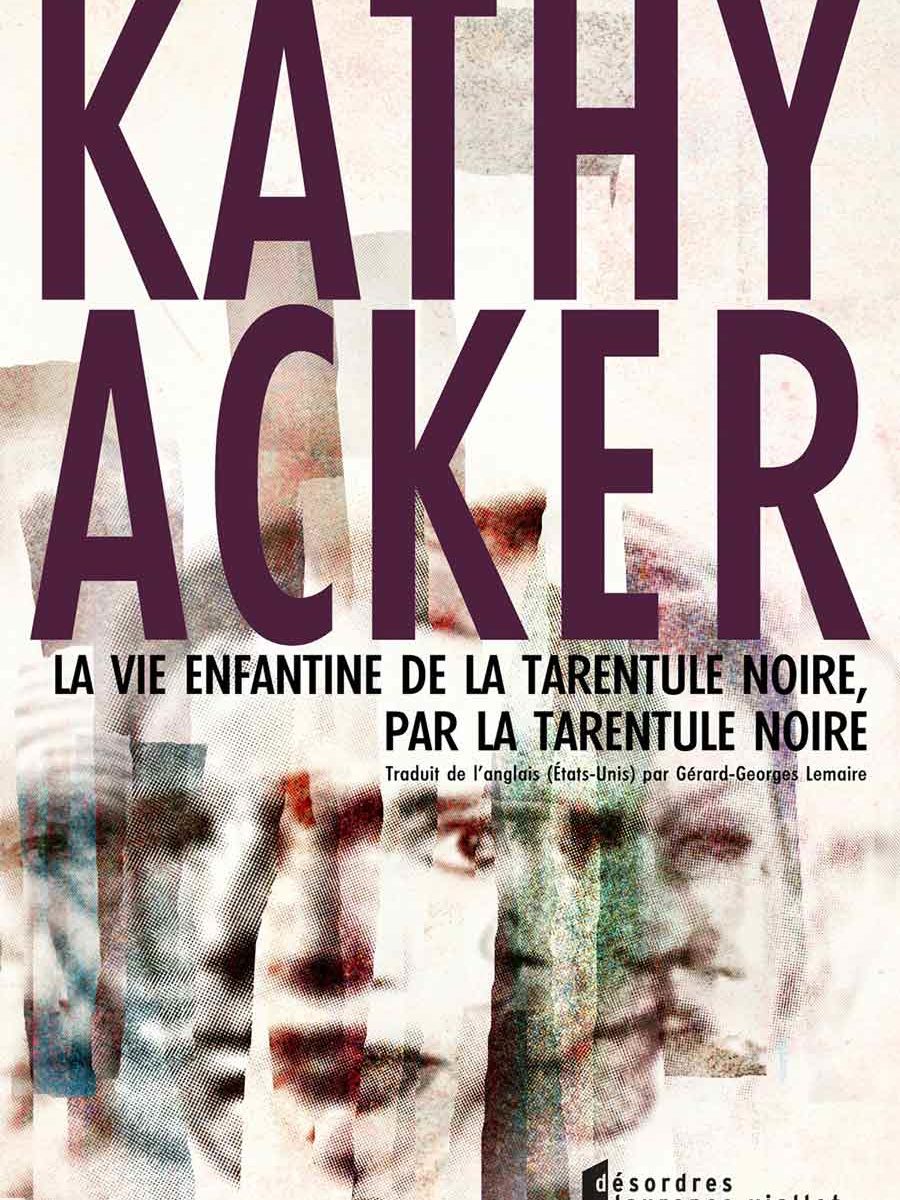J’ai acheté en poche le premier roman qui a été publié de Kathy Acker, Sang et stupre au lycée dans une librairie d’occasion, et avant de rentrer chez moi, je n’avais pas remarqué qu’il avait été annoté au stylo à bille. Il – j’ai toujours pensé que le gribouilleur était un jeune homme puritain et plutôt surexcité – avait entouré d’un rond bleu chaque vilain mot : trois sur la première page, trois sur la deuxième. Apparemment, il en a eu assez aux environs de la page 21, parce que les cercles (cinq pour un paragraphe) s’interrompent alors.
Ce n’est pas la plus élégante des façons de lire l’un des plus audacieux et des plus brillants romanciers américains de ces trente dernières années – un livre sur la politique, le pouvoir, l’écriture, la douleur, qui mêle avec audace le journal d’une adolescente dont le père-amant rencontre une autre femme, à des cartes de rêves griffonnées, des dissertations sur Nathaniel Hawthorne, de la poésie érotique calligraphiée à la main, des parodies de traductions du poète romain Properce, des dialogues imaginaires avec l’écrivain français Jean Genet et la mort et une liaison fantasmée avec l’ex-président Jimmy Carter. Mais cela ne révèle que trop la manière avec laquelle ses admirateurs et ses détracteurs se souviennent de Acker. Sang et stupre au lycée a été interdit en Allemagne et en Afrique du Sud mais a valu à Acker le soutien sans faille du milieu littéraire avant-gardiste. De nos jours, on se souvient d’elle comme la madone d’une littérature post-punk « transgressive », une mauvaise fille arborant tatouages et piercings qui osait écrire sur le sexe avec plus de franchise et moins de sentimentalisme que les hommes ne s’autorisaient alors, ou encore une sorte de bohémienne postmoderne hyper branchée qui aurait ouvert la braguette des lettres américaines. Lorsqu’elle mourut du cancer en 1997, ce journal alloua un petit paragraphe pour annoncer sa mort, titrant sa nécrologie : « Kathy Acker écrivait des romans sur le sexe et la violence. »
Ce rejet guindé était courant. Il concourait, ainsi que les caricatures de son travail moins hostiles mais plus sensationnalistes – prenez la notice nécrologique du Guardian : « Acker, l’auteur scandaleux, est décédée » – à ignorer les plus importantes choses qu’il nous reste d’elle, ses livres. Tout n’est pas perdu. Acker a été l’objet d’une sorte de renaissance l’année dernière. Grove a réalisé une anthologie de son œuvre intitulée Essential Acker, ainsi qu’un livre comprenant deux textes de jeunesse inédits : Rip-Off Red, Girl Detective et The Burning Bombing of America. Un colloque consacré à son œuvre a eu lieu à la New York University en novembre, avec des conférences tenues par quelques géants du monde universitaire postmoderne et féministe tels que Eve Sedwick, Ayatri Spivak et Avital Ronell. Acker, dirait-on, a été canonisée.
Tout ceci ne va pas sans son lot d’ironie. Acker était allergique aux institutions, quelles qu’elles soient, et le monde universitaire occupait le haut de sa liste (bien qu’un temps, elle ait suivi les cours d’Herbert Marcuse à la fin des années soixante à San Diego, et qu’elle ait enseigné en faculté). « Je vous dit de brûler les écoles sur-le-champ », écrivait-elle en 1984 dans My Death My Life by Pier Paolo Pasollini. « Ils vous apprennent à bien écrire. C’est une façon de vous empêcher d’écrire ce que vous voulez. »
Acker écrivait ce qu’elle voulait et elle est morte fauchée – dans une clinique holiste de lutte contre le cancer, à Tijuana, où elle s’était retrouvée en partie parce qu’elle se méfiait de la médecine occidentale et des « professeurs-spécialistes-docteurs en tout genre », en partie parce qu’elle ne pouvait pas s’offrir des soins décents. Elle était née dans une des plus riches familles juives de New York. Son père est parti avant sa naissance et sa mère lui a coupé les vivres après ses dix-huit ans. Quand elle avait une vingtaine d’années, Acker s’est mise à travailler dans une boîte à strip-tease de Times Square, le vrai, avant qu’il ne devienne une sorte de Disneyland. Et elle s’est mise à écrire, envoyant son travail à des amis par la poste, auto-publiant des pamphlets et les vendant au porte-à-porte ou dans des librairies. Le premier texte de Essential Acker, extrait d’un travail intitulé Politics, fut rédigé pendant cette période, elle avait vingt-et-un an, et dès les premières phrases on perçoit clairement deux des obsessions qui marqueront l’œuvre de Acker pendant les décennies à venir : le sexe et l’identité. « le couvre-lit crasseux sur la scène je suis allergique à cette manière de vivre ma vie. La dernière fois que je suis montée sur scène pendant les dix premières minutes j’ai eu l’impression que je n’étais pas moi…»
Quelques années plus tard, dans son œuvre au moins, Acker rechercherait avec ferveur le sens de ce dérèglement, empruntant résolument différents masques littéraires. « Être aussi paranoïaque et schizophrène que possible », écrivait-elle dans son premier roman, The Burning Bombing of America, un manuscrit retrouvé l’année dernière. « Je ne suis pas heureuse mais suis à l’aise », écrit-elle dans le second, Ripp-Off Red, Girl Detective, « quand je suis travestie ». Ripp-Off Red est une parodie punk et noire (écrite en 1973, bien avant la déferlante punk) sur une femme qui décide « de devenir le plus grand détective vivant », et pour se faire, se rend dans un New York décadent, apocalyptique et finit par enquêter sur la mort d’une femme qui l’a séduite dans les toilettes d’un avion. La véritable énigme, comme toujours chez Acker, est l’identité, l’insondable fragmentation du moi, comment conserver son unité, ou mieux encore, la dissoudre entièrement. « Je suis trop vieille pour m’intéresser à l’aspect romantique du sexe », écrit Acker, mais elle s’en préoccupait indéniablement. Elle ne rend pas le sexe sentimental pour un sou, mais c’est pour elle le seul moyen de sortir des limites étroites du sujet. « Je veux que chaque orgasme que je ressens soit un orgasme ultime et infini », écrit-elle en des termes qui résonnent aussi dans ses derniers écrits : « Je veux être capable de trouver une sorte de repos. »
[…]
Dans Essential Acker, qui comprend des extraits des ses textes majeurs, il est assez facile de suivre l’évolution, le développement de sa critique de l’identité et ses tentatives de plus en plus audacieuses de se réapproprier la littérature. Il y a les récits relativement simples et linéaires tels que Kathy Goes to Haiti, ou les expériences pour brouiller les genres dans des vieux textes comme The Adult Life of Toulouse Lautrec, qui a lieu en partie dans un bordel parisien en compagnie d’une femme de chambre nommée Paul Gauguin et de l’élégante « Florida », Key Largo et l’écriture phallocrate deviennent les sabres avec lesquels Ackers agresse la cohésion du « Je » autoritaire. La sélection des textes plus récents est bien choisie, le premier chapitre du Don Quixote de 1986 par exemple, dans lequel le chevalier (une fois encore Acker se travestit), vient juste d’avorter, explique « le désespoir de trouver l’amour dans un monde où l’amour est impossible » ; et un des derniers chapitres de In Memoriam to Identity de 1990, dans lequel Rimbaud, ayant abandonné la poésie pour le commerce, joue le rôle de Jason du Bruit et la Fureur de Faulkner, qui s’est installé dans une banlieue du Connecticut.
Malgré une petite introduction et une préface courtede l’éditeur , chaque extrait est clairement présenté, sans aucun résumé ou explication. C’est parfois frustrant et pourrait déconcerter les non-initiés, mais au final c’est un bienfait : cela permet de lire le texte pour lui-même. Acker était très consciente que son œuvre aurait rarement ce privilège, que le marché met les écrivains face à un dilemme insoluble.
« Aujourd’hui les artistes doivent faire de leur œuvre, leur moi, des objets de marketing, des images de mode changeantes », écrivait-elle en 1981. « La volonté de mettre l’art au premier plan s’en est allée, au revoir ? » Bien sûr, sa phrase se termine sur une ambiguïté, avec une question cruciale, et c’est la même question cruciale qui reste en suspend quant à son héritage littéraire : une femme peut-elle à la fin du xxe siècle américain écrire avec impertinence, brillamment, irrévérencieusement, sans aucun souci de bienséance, sans être réduite à une caricature jetable, une rebelle stylisée ou une salope impudique ? Peut-elle remettre en cause la base indestructible de l’identité sans qu’on essaie de la réduire au silence ? Ces questions demeurent mais, heureusement, l’écriture de Kathy Acker aussi.
Los Angeles Times
2 février 2003
Traduit par Norbert Naigeon