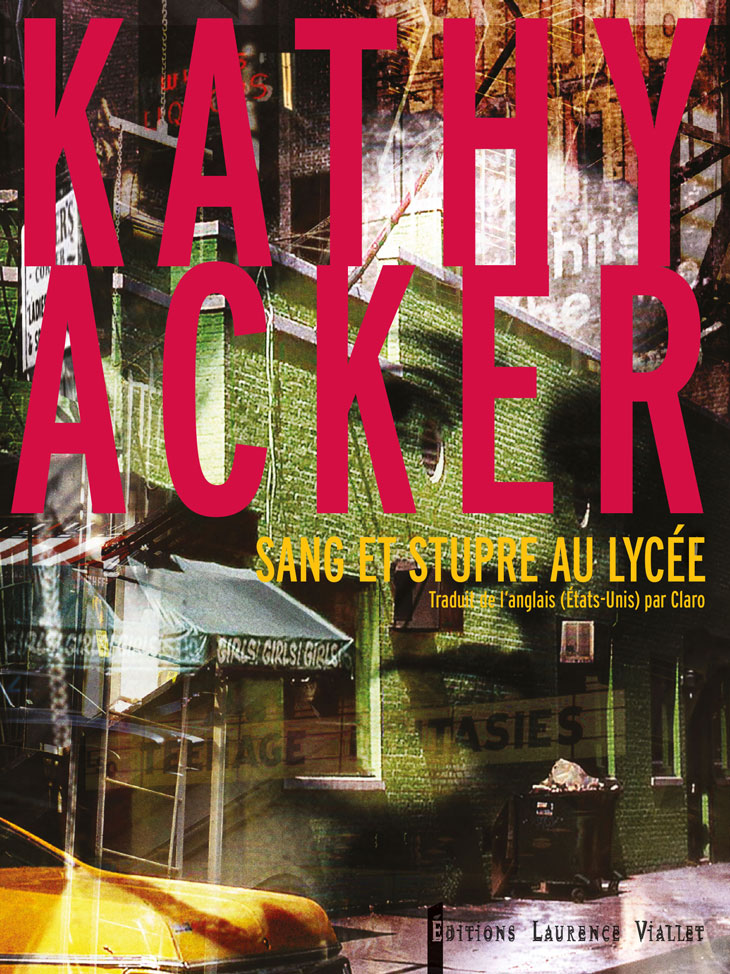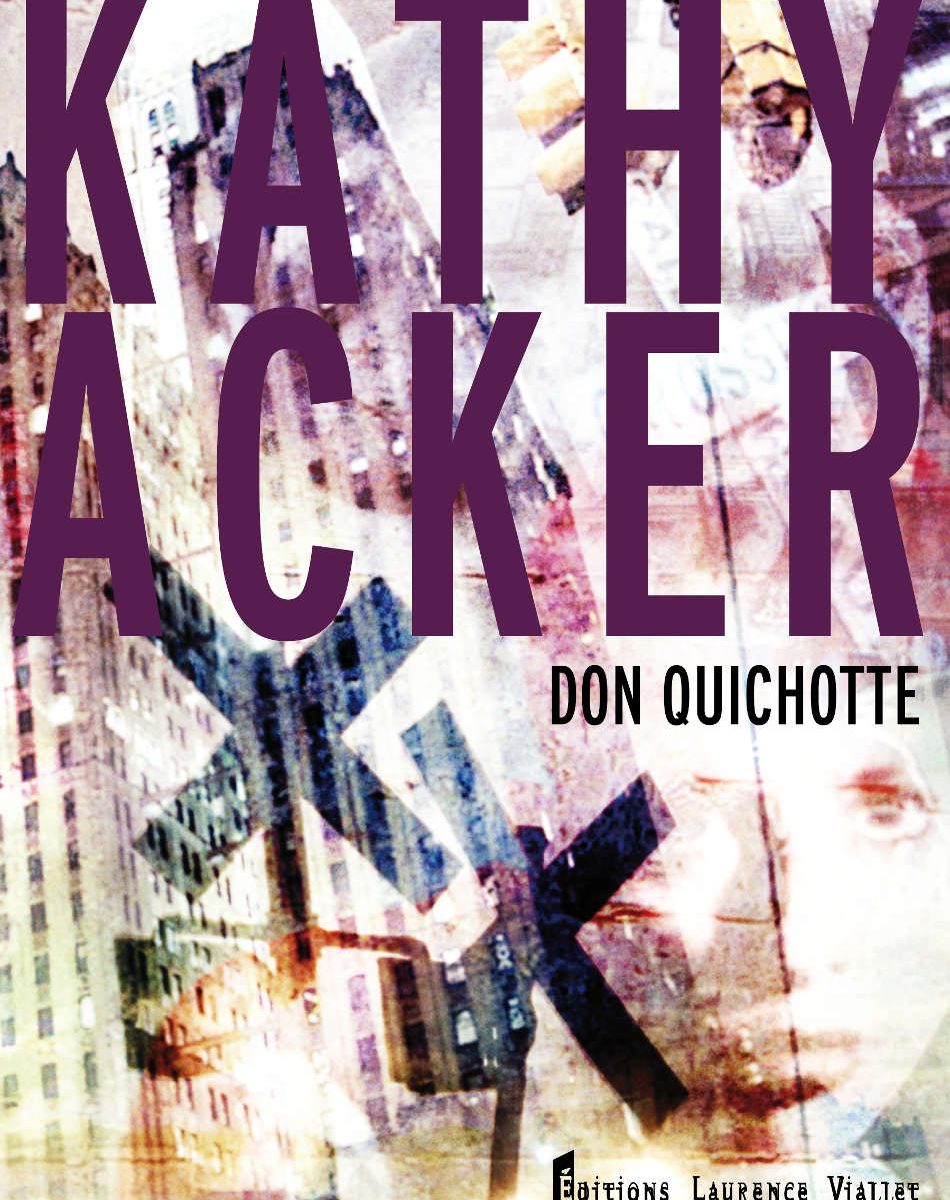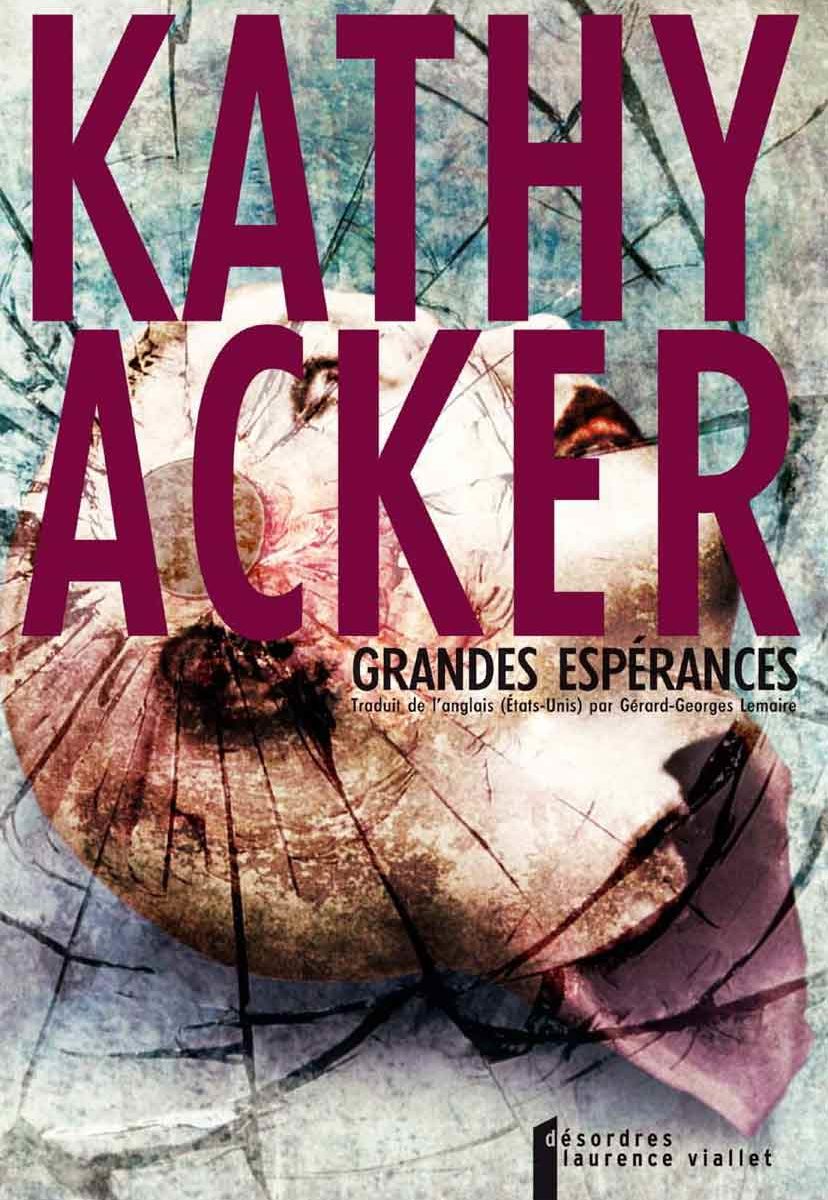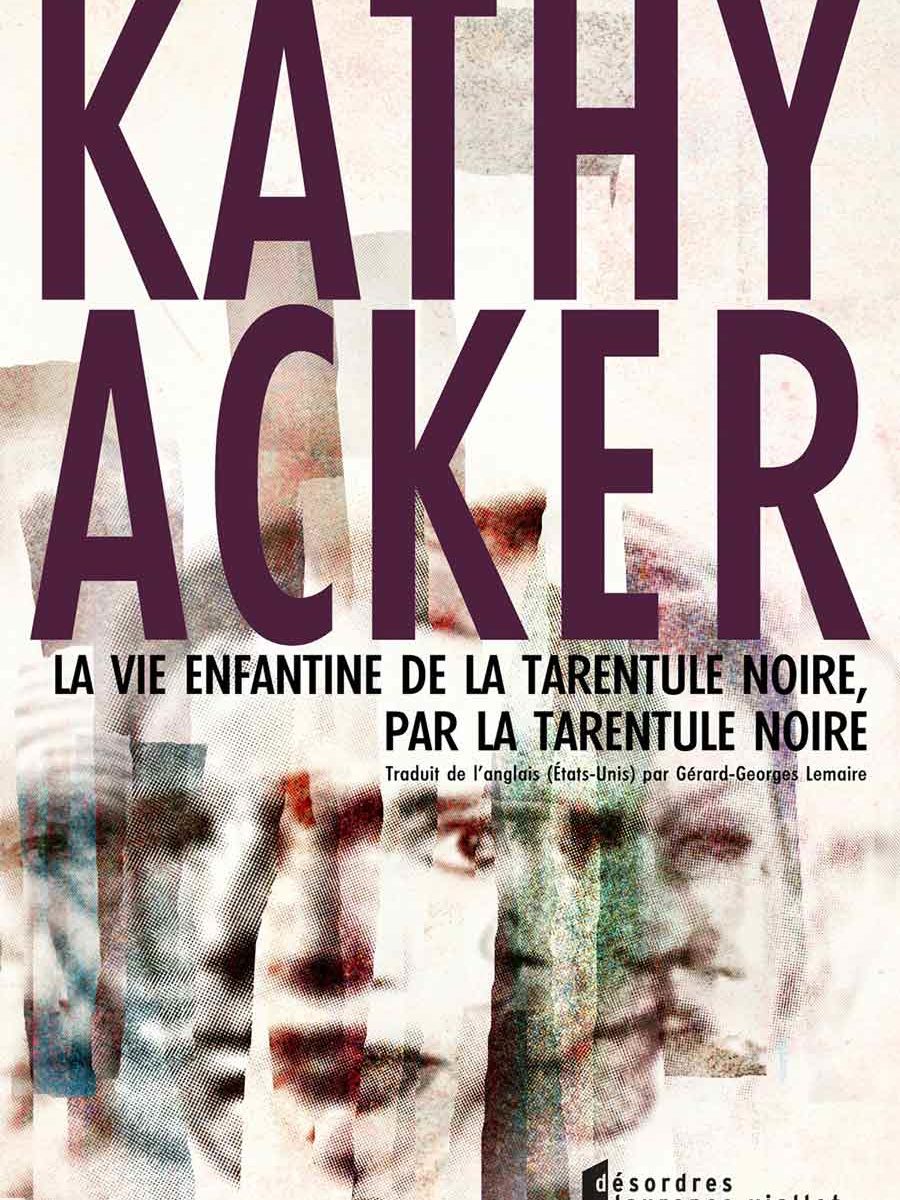L’univers romanesque de Kathy Acker est tout autre que minimaliste. On éprouve même le sentiment que son écriture est d’une nature tellurique. Elle ne connaît ni dieux ni maîtres. Elle semble procéder d’un débordement, d’une éruption violente. Tout en elle porte à croire qu’elle serait le fruit d’une révolte qui ne s’épuise jamais et qui ne trouve d’exutoire que dans la mise à sac du bon goût et du beau en littérature.
Kathy Acker emploie un langage parlé, un langage vernaculaire qui exploite les ressources de l’argot et parfois, sans vergogne, des tournures ordurières. Elle est délibérément vulgaire. Et cette vulgarité forcée se double d’un ton enfantin, qui donne à son style une ambiguïté : il oscille sans cesse entre une dureté extrême et la maladresse fantasque et colorée de l’art brut. On retrouve en effet sous sa plume l’inquiétude et le trouble de certains peintres contemporains. Et, si l’on me permet une image, une image un peu osée, elle peint ses textes, elle leur donne une texture et une matière typiquement picturales.
Une autre image me vient cependant à l’esprit : celle du Lower East Side de New York, où elle a longtemps vécu. Ses fictions ressemblent singulièrement à la Ville Basse, au Downtown de Manhattan, à ces quartiers mal famés qui offrent le spectacle d’une cité abandonnée après une catastrophe ou repeuplée à la suite d’un bombardement. C’est cette atmosphère pesante et angoissante de délabrement et de déchéance qui transpire de ses pages, où la syntaxe est dégradée, tout comme d’ailleurs les règles fondamentales de la construction : il s’agit d’une architecture mutilée, brisée, qui n’est plus que le décor glauque d’un film noir ou d’un feuilleton populaire du xixe siècle.
Cet amour paradoxal des ruines qui gagne le moindre de ses mots trahit ses velléités iconoclastes. Kathy Acker est un écrivain qui place son œuvre à l’enseigne de Saturne, et distille le poison du nihilisme.
Mais qu’on ne juge pas trop vite sa démarche comme le désir autodestructeur d’éroder les formes littéraires et ne plus en laisser transparaître que la corde. Si elle feint de ne respecter rien et personne, elle n’en recherche pas moins une autre dimension scripturale en inventant une mythologie de l’écrivain dans les bas-fonds de Dostoïevski et les décombres de Beckett.
Kathy Acker joue avec le feu de la parodie et du pastiche. Elle n’hésite pas à s’emparer des grands livres, des pièces maîtresses de notre culture pour les dénaturer. Don Quichotte [Don Quixote] et Grandes Espérances [Great Expectations] sont deux titres qu’elle s’est appropriés et qu’elle a pillés impitoyablement. Et les personnages illustres de l’histoire de l’art et des lettres circulent avec la plus grande désinvolture dans des scènes arrachées à des romans célèbres. Mais elle ne se limite pas à mettre le feu au musée borgésien de la mémoire occidentale : elle mêle les références à la haute culture à des emprunts à des formes de cultures populaires, comme le roman policier ou même les bandes dessinées. Leur intrication produit une forte sensation de pandémonium. Elle nous convie à descendre dans les recoins les plus mal famés de l’enfer littéraire. Et, dans ce dernier cercle, on croise, chemin faisant, guidé par cet anti-Virgile, des personnalités comme Alexander Trocchi et William Butler Yeats, Cervantes et Donatien Alphonse François de Sade, Jean Genet et Charles Dickens, John Keats et Marcel Proust. Ceux-ci font bon voisinage avec la Tarentule Noire.
Toutes les fictions de Kathy Acker sont écrites à la première personne. Dans un entretien, elle expose une théorie de la mémoire qui explique cette pseudo-adéquation de l’auteur et de son personnage principal : « Je divise mes réminiscences, pour des raisons fonctionnelles, en trois processus : l’apprentissage, la rétention et le souvenir. Je ne peux sérieusement faire l’expérience de la rétention qu’à travers le souvenir. Expérience : simultanément 1) j’évoque des souvenirs de moi-même. Je fais reposer mon identité, le sens que j’ai de moi, sur ces souvenirs. Je suis moi-même, et aucun autre ; 2) j’apprends en recopiant les Mémoires de quelqu’un d’autre. Je change la troisième personne (troisième personne en relation à moi-même) du livre en la première personne : par conséquent, j’apprends des faits nouveaux sur moi-même. Mon identité repose aussi sur ces mémoires. Est-ce que toutes mes identités ont une valeur ? Est-ce que tous ces souvenirs sont valables ? Comment puis-je dire quels souvenirs et quelles identités de moi sont valables ou non ? Cette schizophrénie est un moyen plus sûr à mes yeux pour atteindre une autre personne, que la rigidité de l’identité, que les rigides structures mentales de l’identité… »
Que ses héros s’appellent Toulouse-Lautrec ou Laure, l’amie de Georges Bataille, Properce ou Van Gogh, c’est toujours « elle » qui s’insinue sous le masque fugitif. Mais, quand elle parle, c’est toujours autrui qui la hante. Ce je qui est encore et toujours un autre joue le double jeu de l’autobiographie et du mensonge. Quelle que soit l’authenticité de la confession de la narratrice (qui peut changer d’identité de chapitre en chapitre, parfois d’un paragraphe au suivant) elle se métamorphose obligatoirement en un artefact. Le je de l’écriture ne peut monter sur la scène de la représentation que déguisé. Et plus il est nu, plus son apparence paraît invraisemblable. La Kathy de Kathy Goes to Haïti n’est pas moins fantasmatique que le Henri Toulouse-Lautrec, auteur de Mémoires imaginaires intitulés The Adult Life of Toulouse-Lautrec. Tous ces êtres provisoires se ressemblent. Ils se comportent avec une similitude étonnante. Et leurs préoccupations se recoupent invariablement. Ils ne sont qu’une seule et même personne. Et pourtant ils sont multiples, interchangeables, transitifs. Ce sont des figurants qui ne sont mis en scène que pour être les véhicules d’un flux verbal qui finit par les absorber et les annuler. On parvient ici à deviner l’influence occulte du théâtre de Gertrude Stein où les rôles s’avèrent de pures voix qui pénètrent des corps et les abandonnent aussi aisément qu’elles les ont possédés. Mais, dans son cas, une voix et une seule transite d’un figurant à un autre, l’anime et le projette dans l’espace. Cette voix, qui se réfracte comme à travers un prisme, est une lumière pulvérisée et dont les éclats sont disséminés.
De cette hétérogénéité poussée au dernier degré, qui finit chaque fois par pervertir l’intrigue originaire, de cet éréthisme latent qui se métamorphose en une sensualité dévorante et sans fard, Kathy Acker tire les fils d’un roman introuvable. Le désenchantement qui provient de l’effondrement général des valeurs et des sens sous-tend un faux roman familial qui, à son tour, est transposé dans une perspective proustienne et flaubertienne.
En somme tout est falsifié dans son œuvre. Tout y est détourné et mal mené. Et, malgré cela, et sans doute pour cette raison, de plagiat en plagiat, de désacralisation en dépeçage, elle met en évidence l’écharde dans la chair de l’homme post-moderne. Elle ne se complaît pas dans la description du drame moral de notre fin de siècle. Elle le vit et nous le fait vivre dans l’outrance et ses écrits s’affirment comme les prolégomènes, à la fois honteux et dionysiaques, à toute métaphysique future.
© Gérard-Georges Lemaire, préface à Grandes espérances