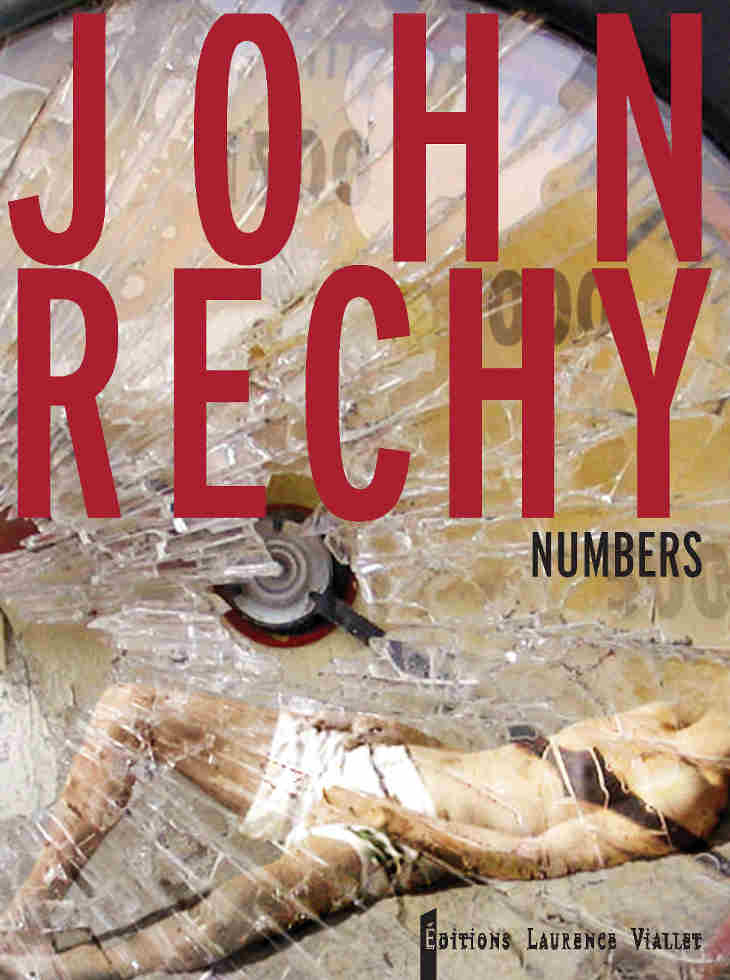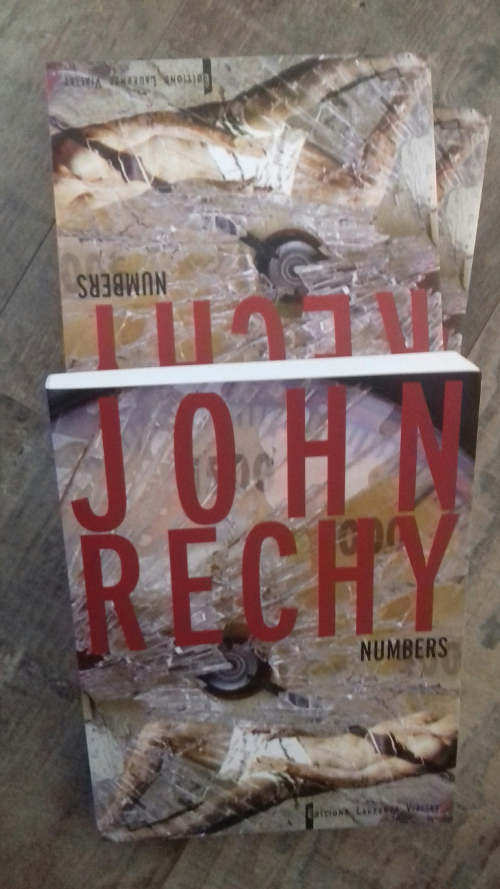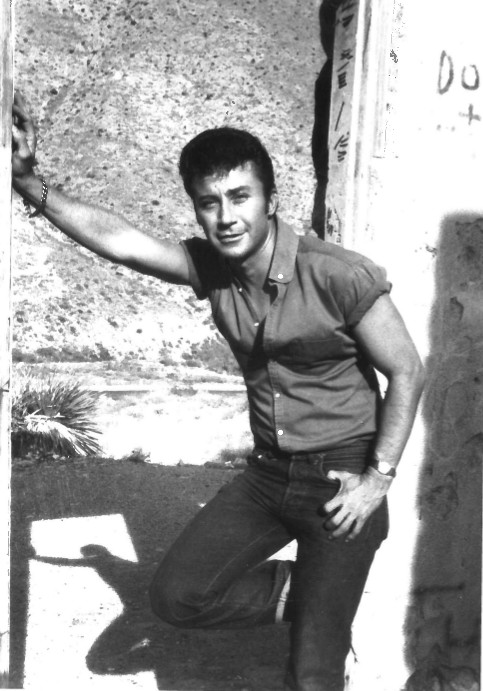Quand vous êtes-vous rendu à Los Angeles la première fois ?
Au milieu des années 50 d’abord, j’y ai habité un court moment, puis j’ai fait des allers et retours, et je suis revenu en 73, et j’y habite depuis.
Entre de Cité de la nuit et Numbers, la description du centre-ville a changé de manière spectaculaire – quand et comment est-ce arrivé ?
C’est arrivé pour se débarrasser des prétendus indésirables, la police a débarqué et viré tout le monde. Ce qui arrive immanquablement lorsque des intérêts immobiliers veulent s’approprier un territoire. Ça a commencé avec le Music Centre et les bâtiments du même genre, il était devenu évident qu’il y avait beaucoup d’argent à se faire de cette manière, et qu’il fallait éjecter ces gens. Le prolongement de cette attitude est qu’il faut ensuite éradiquer toute conduite immorale. Le parc a été nettoyé, et littéralement refait, réaménagé. Cela s’est déplacé vers Hollywood, Hollywood Boulevard a connu le même destin, bien que cela n’ait pas engendré de rénovation, puis le déplacement a continué vers Santa Monica.
Quand on voit le centre, on dirait que quelqu’un a eu l’idée de mettre New York sur la côte et que cela n’a pas vraiment marché.
Exactement, c’est assez extraordinaire. Dans les années cinquante, le centre était totalement différent de ce qu’il est aujourd’hui. Il est beaucoup plus délabré et pauvre de nos jours. Le changement a eu lieu dans les années 60, et a été progressif, il y a tous ces énormes immeubles où vivent des riches, les nouveaux appartements, les cabinets d’avocats…
C’est un endroit où j’ai eu un coup de cœur pour ce qu’il y a de plus recherché dans la pop musique des années 60, et qui parlait de perte et vengeance…
J’ai utilisé beaucoup de paroles dans Cité de la nuit, et en l’écrivant je me suis gavé de tout un tas de vieux rock’n’roll, Elvis Presley, Fats Domino. Je voulais obtenir ce rythme dans la prose, le flux d’énergie qui est au cœur du rock, et dans Numbers à nouveau, toutes sortes de références profondément dissimulées.
Il y a eu une chanson en Angleterre qui s’appelait Numbers par un groupe du nom de Soft Cell [Marc Almond], il y a environ cinq ans, qui a figuré dans le Top 30.
Il y a un bar à Los Angeles qui s’appelle Numbers ! Des choses comme ça sont arrivées. Je me félicite que nombre de musiciens importants aient reconnu mon influence. Jim Morrison m’a rendu une sorte d’hommage dans LA Woman, avec le récurrent « City of Night… ». Tom Waits, Patti Smith. Mick Jagger m’a téléphoné une fois, il était sur le point de faire un scénario. Ça n’a jamais abouti.
Je pense que c’est parce que… Ça fait partie du projet de la musique pop, de faire sortir ce genre de trucs de l’ombre.
Je sais que Gore Vidal a de l’urticaire quand on lui parle de sensibilité homo, qu’il dénie le fait que cela puisse exister, mais j’affirme qu’il y en a une, et c’est tant mieux. Tout ce mouvement a commencé au début des années 60, pas seulement dans les années qui nous semblent faire partie des années 60, le mouvement autour de Warhol avec les 15 minutes, au départ, était nourri par beaucoup d’influences homo. Pour moi, ce qu’a fait Warhol était influencé non seulement par l’homosexualité, comme cela était le cas, mais également par le catholicisme. Les deux donnent un mélange très intéressant.
Un jour je parlais à un homme pour qui Cité de la nuit est l’un des livres incontournables de la littérature américaine moderne, et il m’a demandé ce qui m’avait inspiré, et j’ai répondu que mon écriture avait été profondément influencée par l’église catholique, son décorum ostentatoire. Je regarde beaucoup l’église catholique en terme de travestissement. L’exagération chez Warhol, la décoration des salles étaient très catholiques, le technicolor – la souffrance technicolor, si vous voulez.
Avez-vous été influencé par les Beats ?
Pas vraiment, parce que tout ça se produisait alors que je parcourais le pays, et je n’étais pas vraiment au courant des avant-gardes, et ça ne m’intéressait pas. J’étais très isolé, au sens qu’à nouveau, je jouais un rôle, je ne fréquentais aucun cercle artistique, je traînais dans le milieu que j’ai décrit, feignais de ne pas être intelligent, ce qui était absolument vital, j’apprenais l’argot, et je me le suis complètement approprié.
En dépit du fait que le mouvement beat se déclarait intellectuel, il ne l’était pas, c’était comme un nouvel intellect. Le milieu que je fréquentais, au début, lorsque je suis arrivé pour la première fois à New York, que je faisais le tapin – je crois que c’est dans Cité de la nuit – un homme a vu que j’étais intelligent quand j’ai vu un livre de Colette, que j’ai tendu la main pour l’attraper, et l’homme a dit, est-ce que tu lis ? J’ai dit bien sûr, et il a dit, désolé je n’ai plus envie de toi, t’es pas assez viril.
Vos premiers livres parlaient beaucoup de sexe. Comment ressentez-vous l’impact du sida dans le milieu gay, et par rapport à ce que vous avez écrit ?
Ce qui est horrible avec le sida c’est d’abord qu’il a exterminé, tué tellement des nôtres, mais ce qui est également terrible c’est qu’on puisse le regarder, comme tant de gens l’ont fait, comme une métaphore, un jugement sur notre sexualité. Je trouve cela très dommageable. Ce n’est qu’une maladie mais comme elle est liée au domaine du sexe, la condamnation est toute prête. Personne ne filerait ce genre de métaphore avec la polio, que l’on peut attraper en nageant, ce genre de choses. Je ne parle plus beaucoup de ça maintenant, parce que c’est une époque très dangereuse, la première chose est de s’occuper de la vie.